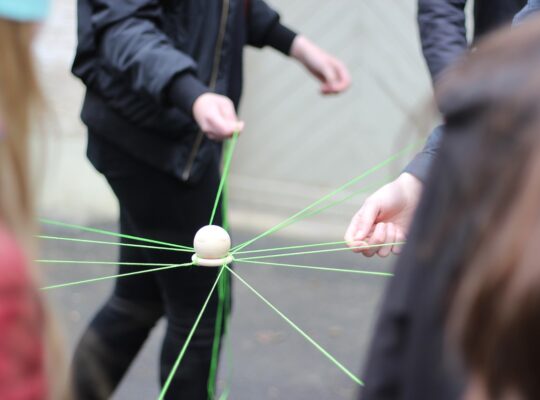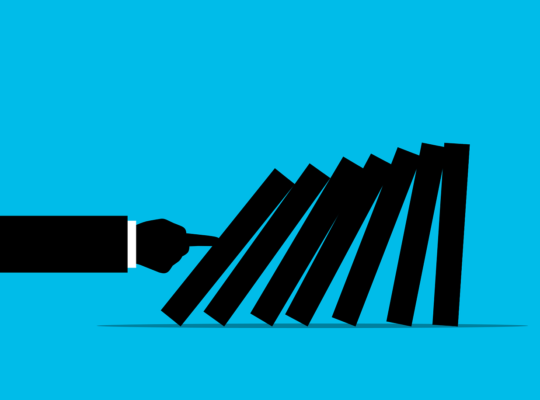Qu’est ce qui peut rassembler décideurs du secteur privé, d’une collectivité, d’un pôle dans une entreprise ou d’ailleurs ? La définition d’objectifs et le fait de vouloir changer l’existant pour aller vers une vision jugée plus optimale, désirable. C’est la réalisation des objectifs qui permet d’atteindre ce but.
Pour aller vers cette réalisation nous l’avons vu les points de leviers en dynamique des systèmes sont d’une grande aide.
Mais pour les utiliser à leur optimum il est important de faire un retour en arrière pour diagnostiquer la situation analysée, la problématique qu’elle sous tend et ce qui la caractérise. Cette étape sous évaluée : celle du diagnostic, celle de comprendre d’où l’on part pour ensuite trouver le chemin jusqu’à la réalisation de la vision est celle qui nous impose de nous intéresser à la notion de complexité.
Défaut d’optimisation du cycle financier, d’allocation des ressources matérielles ou humaines, coordination peu optimale entre processus de production et de vente … ces situations ont toutes en commun une réalité, complexe. Tout comme « pour manager dans la complexité, il faut modifier nos schémas mentaux » (1) il faut nous outiller pour décider dans la complexité, c’est ce que propose Ystem.
Cette complexité, étymologiquement signifie relier, elle renvoie au terme latin complexus qui signifie « ce qui est tissé ensemble ». Dès lors, pour « penser complexe », il faut s’astreindre à un travail de tisserand en reliant les points de vue, les disciplines, les niveaux d’analyse.
Elle peut être précisée et vulgarisée ainsi :
« La complexité d’un système, tient au moins à trois séries de causes :
celles inhérentes à la composition même du système, au nombre et aux caractéristiques de ses éléments et surtout de ses liaisons ;
celles provenant de l’incertitude et des aléas propres à son environnement ;
celles enfin qui tiennent aux rapports ambigus entre déterminisme et hasard apparent, entre ordre et désordre, rapports que de nombreux travaux scientifiques récents ont mis en évidence. » (2).
Les caractéristiques principales que sont notamment l’ambiguïté, c’est à dire le fait que les « interactions (sont) si nombreuses et enchevêtrées » que difficiles à lire et rendent les objectifs incertains et parfois imprévisible (3), sont notamment liées aux rétroactions entre variables, des phénomènes d’accumulation et de retard.
En quelques mots : « de la façon la plus immédiate le sentiment de complexité naît d’abord de la rencontre d’un grand nombre d’éléments constitutifs différents » (4), ce qui est le cas dans beaucoup de situations professionnelles !
La tendance naturelle est vers une simplification trompeuse, car la complexité requiert énormément d’énergie pour se maintenir dans le temps, être comprise. C’est ce pourquoi, Ystem est naît, pour pouvoir traduire la complexité sans la travestir, pour mieux en tirer partie.
C’est pourquoi pour sortir de situations problématiques complexes, il faut comprendre deux choses :
-La première « le monde est trop riche pour pouvoir se décrire en un seul langage, et un seul cerveau ne peut atteindre qu’une connaissance locale. Une révolution considérable est en marche : notre façon de voir le monde et, par conséquent, notre façon de le construire peut s’ouvrir à tous les possibles. On passe en quelque sorte de la s.a (science absolue) à la s.a.r.l. (science à rationalité limitée) » (5). S’ouvre alors un dialogue entre : l’humilité de nos capacités et la compréhension de la complexité de la situation que nous étudions. C’est alors que l’on peut comprendre en tant que décideur la puissance opérationnelle de l’approche systémique et notamment de la dynamique des systèmes (nous y reviendrons).
-La deuxième : dans un monde complexe, il faut « penser en stratège » selon l’auteur réputé au sujet de la pensée complexe qu’est Edgar Morin. Et « le mot stratégie ne désigne pas un programme prédéterminé qu’il suffit d’appliquer ne variatur (sans possibilité de changement) dans le temps. La stratégie permet, à partir d’une décision initiale, d’envisager un certain nombre de scénarios pour l’action, scénarios qui pourront être modifiés selon les informations qui vont arriver en cours d’action et selon les aléas qui vont survenir et perturber l’action » (6).
En l’occurrence la décision initiale est celle de faire appel aux ressources de l’approche systémique.
C’est à ce stade qu’intervient la notion de système, car elle structure l’approche systémique. Le système est « la représentation que l’on va s’efforcer de donner de cet objet ou situation (complexe) » que notre cerveau ne peut traiter que localement, de manière réductrice. « Cette nouvelle manière de voir le monde a un nom : l’approche systémique … Elle s’incarne dans le processus de modélisation » (7). Elle cherche à nous sortir de situations complexes en les traduisant pour nous rendre la vie plus aisée, nous faire prendre les décisions les plus éclairées et optimales.
Il faut bien se rendre compte que « partout autour de nous, des systèmes » (8).
Et que « Rien de plus facile que de trouver des exemples : une cellule, un homme, une entreprise, une agglomération urbaine, un pays, l’économie nationale … » (9) pour Jacques Lesourne qui résume le système comme « un ensemble d’éléments en interaction dynamique » (10).
La définition complémentaire de Francis Le Gallou indique qu’un « système est un ensemble, formant une unité cohérente et autonome, d’objets réels ou conceptuels (éléments matériels, individus, actions… organisés en fonction d’un but (ou d’un ensemble de buts, objectifs, finalités, projets…) au moyen d’un jeu de relations (interrelations mutuelles, interactions dynamiques…), le tout immergé dans un environnement » (11).
Elle est intéressante, car elle nous permet de noter deux éléments structurants d’un système : il est à la fois caractérisé par la notion de mouvement, dynamique et il s’inscrit dans la réponse à une problématique, la quête d’un objectif, d’un but.
La méthodologie d’Ystem permet d’apprécier cette dynamique à la différence de méthodologie basée sur des outils linéaires et statiques, utiles, mais inefficaces dans la complexité. Elle permet également d’étudier et comprendre ce cap du système (parfois implicite et non désiré).
Les systèmes complexes « sont des systèmes à mémoire et à projet » (12), et ce but « se manifeste par les diverses procédures de régulation qui ont pour objet de maintenir, dans la stabilité, le système sur son cap ».
Dès lors, comprendre « D’où partir pour aller où l’on veut » est essentiel. D’où partir est le fait de comprendre et prendre conscience de la complexité, mais cela ne suffit pas à l’action dans un univers complexe. C’est pourquoi, il faut s’intéresser au fait que « Pour agir (de manière plus éclairée et efficiente) nous avons besoin de nous représenter les situations » (13) et c’est ce que permet l’approche systémique. Mais pour tendre vers l’opérationnel et notamment tirer parti de « la richesse du concept de système (qui) ne se dévoile que par l’utilisation qui en est faite » (14), il faut appliquer au sein de votre entreprise ou collectivité des méthodologies qui permettent cela.
C’est la raison d’être d’Ystem de vous accompagner sur cette voie.
Rendre tangible la représentation de votre système, de sa structure, ses variables et les rétroactions à l’œuvre pour analyser la causalité circulaire des situations complexes qu’il engendre et la stabilité dynamique dans laquelle il s’inscrit ! En somme, de la complexité au service d’une chose simple : traiter vos problématiques et vous faire réaliser vos objectifs !
——————
(1) Dominique Genelot, « Manager dans (et avec) la complexité », Eyrolles, 2017.
(2) Daniel Durand, « La sytémique », Puf, 2013.
(3) cf en substance dans Gérard Donnadieu et Michel Karsky, « La systémique, penser et agir dans la complexité », Res-systemica Libri, AFSCET, réédition 2021.
(4) Henri Atlan, « Entre le cristal et la fumée », Le seuil, 1979.
(5) Dominique Genelot, « Manager dans la complexité, réflexions à l’usage des dirigeants ». Insep Editions. 1992.
(6) Edgar Morin, « Introduction à la pensée complexe », Points, 2014.
(7) Gérard Donnadieu et Michel Karsky, « La systémique, penser et agir dans la complexité », Res-systemica Libri, AFSCET, réédition 2021.
(8) Ludwig Von Bertalanffy, « Théorie générale des systèmes », Dunod, 1972.
(9) Jacques Lesourne, « Les systèmes du destin », Dalloz Economie, 1974.
(10) Ibid
(11) Francis Le Gallou, « Présentation de concepts de la systémique », deuxième école européenne de systémique, AFCET, octobre 1992.
(12) Gérard Donnadieu et Michel Karsky, « La systémique, penser et agir dans la complexité », Res-systemica Libri, AFSCET, réédition 2021.
(13) Ibid
(14) Ibid