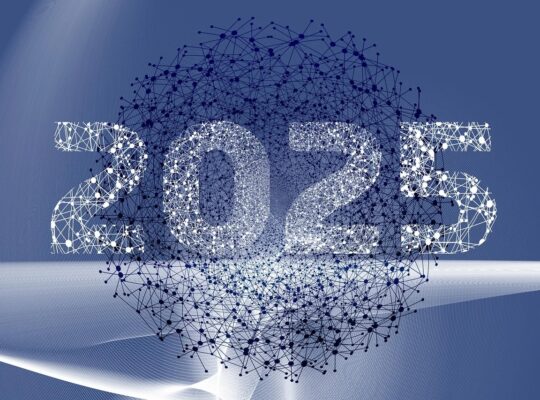« L’approche systémique, en ce qu’elle renvoie à la fois au courant de pensée systémique et à la démarche systémique, apparaît comme opérationnelle, au même titre que la dynamique des systèmes. D’ailleurs, la démarche systémique et la dynamique des systèmes s’appuient sur un certain nombre de processus de mise en œuvre communs : analyse verbale, analyse causale, modélisation, etc. Ces similitudes ne sont pas fortuites, la dynamique des systèmes constituant une méthode, un outil développé sur les bases théoriques de la systémique. En d’autres termes, la dynamique des systèmes n’est pas la systémique, mais elle (en) est une approche, systémique. » (1).
Ces mots, directs, nous montrent en introduction deux choses :
-L’applicabilité, l’opérationnalité de l’approche systémique aux contextes professionnels
-Mais aussi et surtout la méthode que constitue la dynamique des systèmes. Elle est une des ramifications de l’approche systémique, ramification faite par essence pour s’appliquer, à vous, entreprises et collectivités pour éclairer vos problèmes, complexes.
Pour ce qui est de l’approche systémique générale, « au-delà du pragmatisme de la méthodologie, les systémiciens (permettent …) une nouvelle manière de voir les choses, de concevoir le monde, de connaître le réel, … » (2) éclairante pour appréhender la complexité.
Ce mouvement n’arrive en France que tardivement, dans les années 70, et il est porté par des gens comme Piaget ou Delattre. Mais c’est notamment sous l’égide d’Edgar Morin, sociologue de formation, qui explique sa « reconversion théorique » tant il a été marqué par les liens entre cybernétique et complexité, que cette approche va s’y développer. Mais il rencontre, comme ses pairs, des « difficultés auxquelles doivent faire face, encore aujourd’hui, les systémiciens (…) : le poids de l’académisme en France, caractérisé par un cloisonnement des disciplines, apparaît comme un frein (…) » (3).
Il en va de même pour l’application de la dynamique des systèmes dans le monde de l’entreprise, où « le potentiel dans le domaine, qui pourtant existe, n’est pas exploité comme il le devrait. » (4). En effet, dès « les années 70, (…), la dynamique des systèmes ne faisait pas l’objet d’un grand intérêt dans les grandes entreprises : une seule d’entre elles, ELF Aquitaine, tentait d’en développer l’utilisation pour des besoins internes. Dans les années qui suivirent, la dynamique des systèmes (…) gagnait ses lettres de noblesse au sein de l’industrie (Renault, EDF, Pechiney) ou de certains organismes publics tels que le CNRS » (5), mais ce phénomène n’étant pas suivi par une offre de service adéquate sur le marché, a fini par s’étioler.
« Pourtant, l’absence de spécialistes compétents n’amène pas la disparition de la dynamique des systèmes, car les problèmes subsistent. La complexité est toujours aussi difficile à appréhender, et les outils méthodologiques font toujours défaut. » (6). C’est pourquoi, « le besoin d’une approche Dynamique des systèmes renaît, on cherche à nouveau des dynamiciens des systèmes » (7).
En effet, les résultats de la dynamique des systèmes sont probants. « En 1974, Michel Karsky fonde KBS, qui est à l’époque LA société de dynamique des systèmes en France. Il applique la dynamique des systèmes dans de nombreux domaines : économie, physique, management, marketing, biologie, etc. » (8). Il a des clients multiples, des consultants, des entreprises, ainsi que des grandes entreprises françaises et étrangères. Avec le départ en retraite de Michel Karsky, cette société a disparu et son application française elle aussi en partie.
« Alors que le domaine de la dynamique des systèmes semble quelque peu délaissé (…) en France (aux États-Unis, la communauté de dynamiciens des systèmes, bien que confrontée à des problèmes du même ordre, est sans commune mesure beaucoup plus développée), le champ de la systémique (…) semble même être particulièrement porteur ». (9)
Son potentiel est à son image : exponentiel. Car elle permet « en partant d’une représentation très simple du système étudié » et « par un processus de complexification progressif, de construire de manière intelligible un modèle plus complexe, mieux à même de représenter le système » (10) et alors de décider de manière éclairée, efficace, bénéfique.
Elle répond à une question incontournable pour chaque professionnel : celle de la décision la plus juste, habile, éclairée et éclairante. « La question de la décision intervient de manière prépondérante dans les représentations systémiques (…). Préoccupation de nombreux élus et décideurs, ce domaine est en même temps précisément le lieu de leur action. Il n’a pas échappé à ceux qui s’y intéressent que la systémique et la dynamique des systèmes, en ce qu’elles ont vocation à fournir une compréhension inédite de la complexité, pouvaient offrir aux élus et autres décideurs les clés d’une meilleure analyse de la complexité (…) et même, (…) des outils opérationnels d’aide à la décision ». (11)
Mais également elle permet d’avoir souvent un coup d’avance. En effet, « la dynamique des systèmes apparaît comme un outil puissant pour regarder ce qui se passe à moyen et long terme, notamment parce que les phénomènes de rétroaction mettent du temps à devenir agissant ». (12)
Alors pour entrevoir un ROI important, plusieurs étapes doivent être prises en compte par le décideur, et ce avec l’accompagnement d’Ystem.
Car « les deux étapes de la dynamique des systèmes ne reçoivent pas le même accueil. Ainsi, la phase d’analyse causale qui consiste à poser les choses à plat, à essayer de saisir les variables qui entrent en jeu dans le système et les liens qui se tissent entre elles s’avère (…) abordable, et les dirigeants consentent assez facilement à y investir un peu de leur temps ». (13)
Mais dès lors qu’il s’agit de passer à la quantification : « la phase de modélisation (qui) est une phase plus difficile, (où) si la présence et la participation des décideurs n’est pas requise tout au long du processus, elle l’est au moins un minimum. À défaut d’un investissement intellectuel et en temps suffisant de la part du décideur, l’outil apparaîtra au final comme une boîte noire dont les résultats risquent d’être rejetés s’ils apparaissent – et ils apparaissent presque toujours – comme contre-intuitifs par rapport à ce que le décideur croit savoir du phénomène étudié. Ce qui apparaît ici, c’est le caractère indissociable des études et de celui qui les commande, dans la mesure où cela veut dire qu’il a consenti à faire l’effort de compréhension nécessaire. Le succès d’un modèle est (en partie) tributaire de l’implication de ceux qui en auront l’usage. » (14)
Alors que « L’investissement consenti dans la première phase de la systémique est déjà une victoire remarquable (car elle permet d’) amener un décideur à envisager un problème complexe à travers une analyse systémique rigoureuse (…) » (15) , le retour sur investissement, qui peut être extrêmement important, dépend aussi de la volonté du/des décideur(s).
Ystem est en mesure de vous proposer différents niveaux de solutions, qui ont tous des intérêts pour votre entreprise. En revanche, plus votre investissement est important, plus le retour le sera, et ce de manière non pas linéaire, mais exponentielle.
Mais nous lançons le débat dans la lignée de l’autrice : « Si l’investissement en temps n’est pas consenti, peut-être faut-il se contenter de fournir la boîte noire. Mais alors, (…) une question de forme, celle de l’interface du logiciel, devient fondamentale. La difficulté est de proposer un logiciel d’utilisation qui offre à son utilisateur à la fois la simplicité d’un outil manipulable par des non-initiés et la complexité nécessaire à l’élaboration et au test de plusieurs scénarios s’appuyant sur des ajustements fins. L’effort à fournir en termes de communicabilité de l’outil est particulièrement important ». Mais également « Se pose ensuite une question de fond qui touche à la légitimité de l’utilisateur ignorant ce qui se passe au niveau de la boîte noire ». (16)
Ystem pour les raisons évoquées, propose un accompagnement permettant d’éviter cet aspect « boîte noire », et le défaut de recul vis-à-vis du modèle entachant ainsi la légitimité de l’utilisateur.
Également capable de fournir une méthode a minima, l’interrogation est posée : seriez-vous plus enclin à utiliser cette méthode sans accompagnement ? Quitte à sacrifier une bonne partie du ROI potentiel. Ou préfériez-vous un accompagnement pour pousser les capacités de manière optimale de cette approche stratégique ?
À vous la parole : https://framaforms.org/sinvestir-sur-la-dynamique-des-systemes-un-retour-payant-1691675272
—————
(1) : Page 71, Aurore Cambien. Une introduction à l’approche systémique : appréhender la complexité. [Rapport de recherche] Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU). 2008, 84 p., figures, graphiques, bibliographie – Date d’achèvement: février 2007. hal- 02150426
(2) : Ibid
(3) : Page 72, , Aurore Cambien. Une introduction à l’approche systémique : appréhender la complexité. [Rapport de recherche] Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU). 2008, 84 p., figures, graphiques, bibliographie – Date d’achèvement: février 2007. hal- 02150426
(4) : Ibid
(5) : Ibid
(6) : Page 73, , Aurore Cambien. Une introduction à l’approche systémique : appréhender la complexité. [Rapport de recherche] Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU). 2008, 84 p., figures, graphiques, bibliographie – Date d’achèvement: février 2007. hal- 02150426
(7) : Ibid
(8) : Ibid
(9) : Page 74, , Aurore Cambien. Une introduction à l’approche systémique : appréhender la complexité. [Rapport de recherche] Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU). 2008, 84 p., figures, graphiques, bibliographie – Date d’achèvement: février 2007. hal- 02150426
(10) : Page 53, , Aurore Cambien. Une introduction à l’approche systémique : appréhender la complexité. [Rapport de recherche] Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU). 2008, 84 p., figures, graphiques, bibliographie – Date d’achèvement: février 2007. hal- 02150426
(11) : Page 75, , Aurore Cambien. Une introduction à l’approche systémique : appréhender la complexité. [Rapport de recherche] Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU). 2008, 84 p., figures, graphiques, bibliographie – Date d’achèvement: février 2007. hal- 02150426
(12) : Ibid
(13) : Ibid
(14) : Ibid
(15) : Ibid
(16) : Ibid
———————